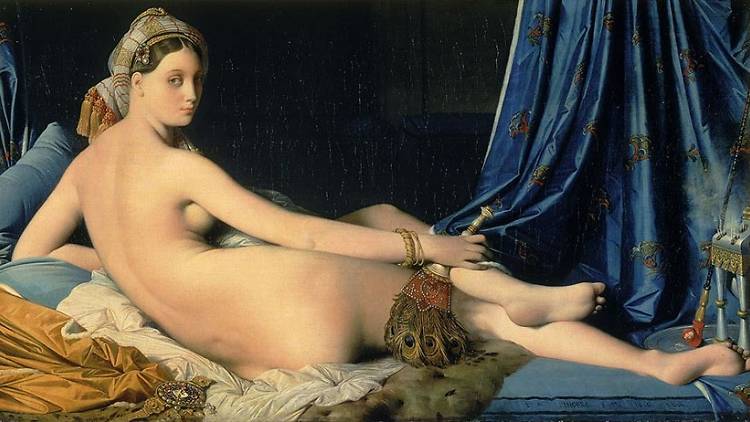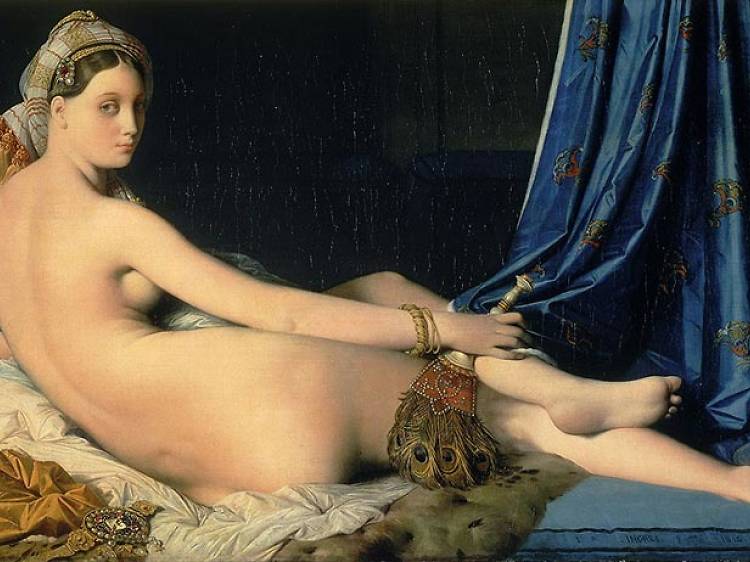Se pencher sur les symboles cachés que renferment les chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, c'est poser le pied sur un terrain glissant. Ouvrir la porte d'un monde parallèle habité de geeks illuminés et de fans de Dan Brown ; se frotter à des théories démentielles, des décryptages tirés par les cheveux et des hallucinations à la limite de la paranoïa aigüe. Eh oui, bien mal nous en a pris, au cours de nos recherches la curiosité nous a poussés à consulter l'ami Google et, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas été déçus. En caressant la barre de recherche dans le sens du poil, nous sommes tombés sur une mine d'or de blogs complètement perchés qui nous ont notamment permis de découvrir que des agneaux, des serpents, des cercueils et des mots cryptés en anglais (« Judgement Day », « Japan », « Ending »...) se cachaient dans la plupart des tableaux de Van Gogh (si, si).
Heureusement, nos lointains souvenirs de cours d'histoire de l'art et des sources autrement saines d'esprit nous ont remis dans le droit chemin, et grâce à elles nous avons pu retenir une petite sélection d'œuvres qui ont, indubitablement, quelque chose à cacher : un symbole improbable, un message cocasse, un détail qui fâche, une boutade. Car si le sujet nourrit autant de fantasmes, c'est bien parce que les arts plastiques ont toujours été un terrain propice à l'énigme, d'innombrables artistes ayant succombé à la tentation de glisser de petites audaces dans leur travail. Autant de secrets de Polichinelle invisibles au premier coup d'œil, destinés à éluder la censure, à se venger d'un mécène radin, à mettre un peu de mystère ou de piment dans une toile... C'est la récente polémique autour du lapin glissé par les sculpteurs dans l'oreille de la statue de Mandela à Prétoria en signe de protestation contre leurs conditions de travail qui nous a donné envie de nous pencher sur d'autres œuvres qui s'évertuent, elles aussi, à occulter le fond de leurs pensées. De Man Ray à Corot et de Vermeer à Michel-Ange : quelques exemples qui devraient vous aider à mettre les groupies du 'Da Vinci Code' à l'amende (cliquer sur la flèche à droite de l'image pour activer le diaporama).
•••
Lait chaud.
Jean Vermeer, 'La Laitière', c. 1660
Au XXe siècle, c’étaient les hôtesses de l’air. Au XVIIe aux Pays-Bas, on allait chercher moins loin : pour faire rêver les mecs, le summum du sex appeal c’était d’opter pour la filière laitière (même pas besoin de BEP). Un boulot de coquine qui n’est pas passé inaperçu de l’œil concupiscent de Jean Vermeer. Dans cette fameuse toile, la laitière s’impose au premier abord comme un modèle de vertu – pure, généreuse, nourricière, elle prépare un repas dans un intérieur humble, sagement concentrée sur sa tâche.
Mais en regardant de plus près, quelques détails suggestifs viennent rancir la facture idéale du portrait. Après tout, madame, plantureuse, cruche en main, s’échine à faire couler un nectar blanc qui n’est pas sans rappeler d’autres fluides corporels, sensiblement de la même couleur. Quand on connaît la réputation des soubrettes-option-laitages de l’époque, on peut facilement y déceler une métaphore un brin lascive. Et si ce n’était pas suffisant, le peintre flamand en rajoute une couche, à peine visible, dans la partie inférieure droite de son tableau. Derrière le petit objet rectangulaire (une chaufferette, dont on se servait pour se réchauffer les pieds), sur les petits carreaux de faïence à l’hollandaise, on distingue parmi les motifs bleus un petit Cupidon (à gauche). Autant d’éléments camouflés qui lorgnent vers le désir charnel et ont donné lieu à des interprétations parfois plausibles, parfois tirées par les cheveux, mais qui laissent en tout cas planer le mystère sur ce chef-d’œuvre de la peinture flamande.
Voir aussi
Discover Time Out original video